Les objets de la vie sociale
Comme pour se distinguer d'une théorie strictement économique, voire économiste, nombre d'auteurs se consacrent à définir par le menu les objets environnant l'homme comme n'ayant pas qu'une nature marchande. Ils possèdent bien d'autres attributs que d'être au centre de l'échange marchand. Ainsi le cadre de l'échange marchand devient, chez les conventionnalistes, un cadre d'action parmi d'autres et non un cadre général. Dans ces autres cadres de l'action, les individus ont des motivations qui ne relèvent pas de calculs d'optimisation relevant de la rationalité économique.Doués de raison et agissant avec les autres, ils commettent des actions dont ils doivent rendre compte. Ce sont des êtres raisonnables et leur action est justifiable. Nos auteurs se réfèrent là aux fameuses agrégations des comportements individuels.
Dans l'échange marchand, le principe de justification est la rationalité. Mais il serait faux d'étendre cette forme de rationalité à tous les cadres de l'action comme on peut le constater à travers les arguments que donnent les individus pour justifier leur conduite. En effet, il y a une pluralité de cadres d'action dans la complexité de l'univers. Comme il y a une multitude de subjectivités liées à la multitude des argumentations des individus, le recours à des objets extérieurs constitue le noyau tangible de leur justification. ces objets peuvent être matériels ou symboliques. Dans l'univers marchand, les objets sont des biens avec les caractéristiques définies par la théorie économique. : ils sont anonymes, construits pour l'échange, différenciés par un prix. Dans d'autres monde, ils prennent d'autres formes, par exemple dans l'univers domestique, ils ont une "valeur d'usage". (BOLTANSKI et THÉVENOT, 1987).
Chaque monde a ses objets et "lorsque des objets ou leur combinaison dans des dispositifs plus compliqués sont agencés avec des personnes, dans des situations qui se tiennent, on peut dire qu'ils contribuent à objectiver la grandeur des personnes". (Idem). Dans chaque monde il y a donc une cohérence entre les objets et les personnes. En ce sens, le conventionnalisme propose un modèle universel (THÉVENOT et collaborateurs, 1989) qui s'énonce, sous des contraintes de même type, en trois concepts : justification (versus rationalité économique), mode de coordination (versus marché) et objectivité (versus biens). A partir e l'action des hommes, fondée sur le fonctionnement de ces concepts, se construit la réalité sociale qui n'est plus une donnée naturelle, mais un résultat des interactions humaines mobilisant la raison, les univers où s'expérimente la réalité humaine plurielle et les objets. Ceux-ci sont le résultat de l'activité mentale des hommes. : ils peuvent être des objets physiques (ou symboliques) qui sont alors des biens marchands (dans le monde ou l'univers marchand, leur nature est alors marchande) ou des biens domestiques (dans le monde domestique) : les objets peuvent être aussi des règles ou des normes sociales. Dans tous les cas, il s'agit de "construits sociaux" nés d'un accord entre les hommes, lequel qualifie l'objet, c'est-à-dire lui attribue une nature, autrement dit une "fonction" sociale dans un univers donné. Les objets sont donc fruit de conventions et non des données de toujours, extérieures à la négociation entre les hommes.
Il y a bien pour le conventionnalisme une ambition à se présenter comme une conception philosophique de la société et un cadre général d'analyse à partir de l'action des individus autour des trois concepts cités ci-dessus. (DURAND et WEIL). Même si ceci est une présentation très globale, on ne peut s'empêcher de penser, en regard des avancées de l'économie et de la sociologie à leur époque, que les auteurs ne font pas preuve d'une trop forte économie de moyens pour articuler les choses. Ils ne parviennent d'ailleurs pas au niveau des élaborations qui les précèdent des notions de valeur d'usage et de valeur d'échange. On pourrait penser que les auteurs abordent la question de contradictions entre ces deux valeurs dans de nombreux objets accaparés par les échanges économiques, mais ils évitent soigneusement toute analyse de ces conflits. Il est vrai que s'ils le faisaient, cela rappellerait aux destinataires directs et commanditaires (ou financeurs) de leurs études des notions marxistes ou marxisantes absolument à éviter!
La logique de l'action : la justification
Le conventionnalisme repose sur des postulats. Par conséquent, la forme privilégiée en est la modélisation. Ce qui lui donne une apparence formelle rigoureuse, qui rappelle furieusement la frénésie pour les représentations mathématiques des théories économiques dans les différents manuels officiels en vigueur dans nombre d'universités.
Ainsi, il construit un cadre général des logiques d'action en donnant des hypothèses sur ce qui correspondrait au concept sociologique de motivation. S'inspirant des sciences morales et politiques, cette théorie affirme que le lien qui unit l'être particulier qu'est l'homme à ses semblables (la communauté), c'est l'impératif de justification. "Cet impératif de justification est même un attribut caractérisant ce en quoi les personnes sont humaines... Comment une science de la société peut-elle espérer aboutir en ignorant délibérément une propriété fondamentale de son objet, et en négligeant que les gens sont confrontés à l'exigence d'avoir à répondre de leurs conduites, preuves à l'appui, auprès d'autres personnes avec qui elles agissent?" (THÉVENOT et collaborateurs, 1989) ; BOLTANSKY et THÉVENOT, 1991). Cette théorie commence par sa propre justification, c'est-à-dire, la preuve expérimentale, la négation de l'affirmation arbitraire. Chacun d'entre nous peut en vérifier le bien-fondé : il suffit d'être attentif aux justifications que développent les personnes en paroles et en actes, et qui "comme des savants, ne cessent de suspecter, de soumettre le monde à des épreuves". (Idem).
Les actions de l'individu sont donc justifiables. Elles sont raisonnables en ce qu'elles s'appuient sur les raisons qui motivent sa décision et qu'elles sont compréhensibles par tous. On dira que "l'exigence de bonne raison se confond avec celle d'acceptabilité par les autres et d'objectivité pour constituer une même catégorie du raisonnable (THÉVENOT et collaborateurs, 1989). La construction d'un modèle d'action raisonnable suppose de transcender la contingence de la situation où se déroule l'action, car ayant une portée générale, elle repose sur une mise en équivalence avec d'autres situations. Cette exigence de généralité demande un mode de rapprochement fondé. Il faut donc concilier deux hypothèses : la possibilité de fonder des actions coordonnées sur un principe commun et la disponibilité d'une pluralité de ces principes. Ce sont ces propositions que présentent les Économies de la grandeur, à travers le "modèle d'action raisonnable compatible avec ces deux hypothèses" (Idem). ( DURAND et WEIL)
L'insistance sur la justification provient directement du fait que ces auteurs refusent d'admettre que dans bien des cas, les comportements sont imposés par les institutions (par exemple éducatives), sans que les individus ne se posent la moindre question sur la justification de ces impositions... Par ailleurs, on ne peut s'empêcher de faire le rapprochement entre l'obsession de la conformité (conformisme et apparence extérieure) dans certaines sociétés et cette justification individuelle des comportements.
L'essence de l'homme définie par six axiomes
Une sociologie si centrée sur l'individu ne peut faire l'économie d'une définition de l'essence de l'homme. Si la logique de l'action est la justification de l'action vis-à-vis d'autrui, les ressort de l'action dépendent de cette essence, de ce qui le qualifie en tant qu'homme.
Si axiomes définissent ce que sont les individus vivant dans les société habituées à la négociation et non aux rapports de force. C'est ainsi que le conventionnalisme voit les sociétés modernes (industrielles), excluant de son champ de réflexion celles où règne la violence politique ouverte. Ce sont les sociétés ou "cités marquées par la philosophie politique moderne" (BOLTANSKI et THÉVENOT, 1991).
Dans ces sociétés où "la rationalité des conduites peut être mise à l'épreuve" (BOLTANSKI et THÉVENOT, 1987), on aboutit toujours à "la maitrise pratique des justices fondées en principe" (Idem).
Pour pouvoir négocier, il faut donc que les hommes soient tous dotés d'une commune humanité (axiome 1) qui les prédispose à agir pour le bien commun par voie d'accords et non de violence. Ils ne sont pas condamnés à un seul état et peuvent en trouver au moins un équivalent à un autre (axiome 2), sans cela ils ne seraient pas motivés à l'action. Ils peuvent accéder à un même état de richesses ou une commune dignité (axiome 3). Il y a un ordre relatif aux états qui qualifient les personnes, ce qui peut les rendre insatisfaits, et leur donne le désir d'en changer (axiome 4), mais elles savent qu'il y a un coût (axiome 5). Le dernier axiome, le 6ème, est l'existence du bien commun, lequel permet de parvenir à un accord (clôturer l'accord).
Des commentateurs désobligeants (...) pourraient considérer que cette description de l'homme moderne est bien maigre et se demandent ce qu'il en est des multiples conflits sociaux qui agitent ces sociétés "marquées par la philosophie politique moderne". Quelles sont donc ces sociétés non mues par des rapports de force? Lesquels sont sans doute un peu vite assimilés à de la violence... Cet homme gentillet semble bien celui souhaité par nombre de dirigeants politiques et économiques...
Modes de coordination de l'action entre individus
La conventionnalisme se distinguant par la recherche des ressorts de la coopération (exclusivement) entre les individus, il est logique que ses chercheurs explorent divers modes de coordination de l'action ente individus. Il s'agit donc de comprendre comment les personnes conduisent des actions raisonnables compatibles avec les hypothèses de la nécessité de rendre compte de leurs actions de façon acceptable pour autrui : il faut définit le cadre de telles actions.
Trois autres axiomes sont alors énoncés :
- Multiplicité des mondes : l'action se déroule dans un monde ou dans un univers à plusieurs natures (axiome 1) (THÉVENOT et collaborateurs, 1989-. L'action, pour être justifiable, doit pouvoir transcender la particularité et la subjectivité de celui qui la justifie. L'introduction de phénomènes de preuve apparaît nécessaire. L'objectivité est ce qui sert d'appui à une action justifiable ; elle est caractéristique d'une nature. La présence d'objets dans l'action sert de ressources aux individus.
- Les objets n'ont qu'une nature et une seule référée au monde qui les caractérise dans une situation donnée (axiome 2). Ainsi, "l'objectivité industrielle de l'ingénieur, celle des appareils de mesure et des lois statistiques qui suppose stabilité et standardisation, trouve sa place parmi d'autres (...) L'objectivité marchande du bien n'est pas moins objective et déterminante pour l'action intéressée" (Idem). L'importance de cette nature de l'objet apparaît lorsqu'elle fait défaut, insinuant le doute sur la qualité de l'objet dans l'action et mine les fondements de la forme de coordination, c'est-à-dire, du cadre de l'action des hommes.
- Les hommes ont plusieurs natures. Tout comme les objets, les hommes doivent être qualifiés, c'est-à-dire, identifiés, dans le cadre d'une action raisonnable. Mais à la différence des objets, les hommes peuvent être qualifiés dans toutes les natures (axiome 3). Si l'économie néo-classique n'envisageait qu'une rationalité, le conventionnalisme considère que l'homme en possède plusieurs : l'homme est raisonnable, il peut argumenter ; il peut changer de nature mais il devra justifier son action selon le monde concerné. (DURAND et WEIL)
On sent là l'expression de l'impérieuse nécessité de sortir d'un économisme qui attribuait à l'homme qu'une seule nature (homo oeconomicus) et ne se situait que sur un seul plan d'existence (l'économie...), condition pour qu'émerge une véritable sociologie qui aborde des domaines particuliers et divers de la vie sociale...
Modèle commun et relation d'équivalence
L'existence d'un bien commun (axiome 6) qui dépasse les singularités de individus conduit à la reconnaissance d'un modèle commun à tous les mondes de l'action en général. En même temps, à l'intérieur de chaque monde, une relation d'équivalence organise la cohérence de la rationalité du monde concerné entre la nature des objets, la nature des hommes, la logique de négociation (et l'accord), etc.
Dans le modèle commun à tous les cadres de l'action présentant un forme de généralité, à toute forme de coordination correspond un ordre, rendant compte de "la possibilité de clôture d'un équilibre sur l'une ou l'autre des différentes natures". Chaque nature repose sur une forme de généralité que l'on peut considérer comme une relation d'équivalence (THÉVENOT et collaborateurs, 1989). La relation d'équivalence dote des mêmes propriétés les êtres, que ce soient des humains et/ou des objets. Cette notion permet d'exprimer la coïncidence/non coïncidence de nature des objets ou des êtres humains dans une même cité. A l'intérieur de chaque cité (ou nature ou monde) il y a une relation d'ordre qui définit l'importance des individus, importance dont ils peuvent contester l'attribution. Ils peuvent ainsi soumettre à l'épreuve l'ordre de la cité et l'allocation des grandeurs. Mais la construction d'une équivalence entre des personnes permet aussi de faire émerger un intérêt commun. En effet, "cette relation fondamentale est un principe d'identification des êtres, considéré dans chaque nature, comme plus général que toutes les autres formes de rapprochement jugées plus contingentes, et tenu pour commun à tous" (idem). C'est le "principe supérieur commun" qui permet de dire que a équivaut à b, c'est-à-dire de "constituer l'équivalence des états de grandeur, (de) faire la mesure des choses" (BOLTANSKI et THÉVENOT, 1987).
Dans chaque nature définie ainsi, un "principe supérieur commun" définit donc la structure mais produit des hiérarchies en même temps, car il donne un ordre sur l'importance des être d'où le terme de grandeur donnée à cette qualité. Dans chaque nature (ou monde), objets et personnes sont donc ordonnés selon leur grandeur, suivant leur importance en regard du principe supérieur commun qui les qualifie. Tenu pour commun à tous, le principe supérieur est aussi le bien commun dans l'action justifiable. Cette hypothèse d'ordre est considérée comme un élément permettant de passer de la perspective d'une nature unique (la rationalité marchande de l'économie néo-classique) à celle d'un univers à plusieurs natures, car "l'ordre construit, autour de chaque forme de justification, la possibilité de réduire la tension inhérente à la disponibilité d'autres principes généraux de qualification, sans éliminer totalement la trace de ces autres monde possibles et leur fermer tout accès" (THÉVENOT et al., 1989). (DURAND et WEIL)
Cette présentation de nos deux auteurs-guide nous a laissé un peu perplexe, mais vérification faite - lecture de deux ouvrages clés de THÉVENOT et BOLTANSKI), elle correpond effectivement à ce qu'on en tirer, en en restant aux principes - effectivement assez abrupts - qui rappellent certaines docte définitions en économie. Mais en y regardant bien, on s'aperçoit - outre cette insistance à mettre sur le même plan hommes et objets - qu'il s'agit bien d'une mise en forme d'un principe d'intérêt commun (général) qui tout en s'imposant aux individus qui justifient leur action, se trouve pris dans des considérations d'ordre social, lequel se trouve bien mis en avant pour guider toutes les collaborations et tous les accords. L'ordre social, l'intérêt commun, l'équivalence des états de grandeur, tout cela conduit à ces nécessaires coopérations, qui font la société. On pourra toujours contester sa place dans l'ordre, mais en fonction même de cet ordre. Tout en faisant mine d'ouvrir cette nouvelle sociologie à des mondes multiples, il semble bien qu'on la ferme finalement dans une sorte d'obligation du respect du bien commun. Mais il faut en savoir plus sur ces mondes pour se faire une idée juste de cette théorie et il faut l'écrire, de cette théorisation, qui, en regard de tout le savoir sociologique accumulé jusque-là, apparait bien pauvre... Comme si on tentait d'élaborer un nouveau vocabulaire et une nouvelle grammaire pour en définitive retomber sur des notions néo-libérales...
Les six mondes ou cités
La relation d'équivalence peut définir un nombre indéterminé de natures. Mais le repérage effectué dans les grands ouvrages de philosophie politique et morale (BOLTANSKI et THÉVENOT, 1987) permet d'en dénombrer six grands types caractérisant le cadre de l'action, soit six grands types de cités : la cité marchande, le cité de Dieu, celle du renom (ou de l'opinion), la cité domestique, la cité civique, la cité industrielle.
- La cité marchande : Adam SMITH a formalisé, le premier, dans les relations marchandes un principe universel de justification permettant de fonder une cité sur ce principe. La cité marchande garantit la paix et est telle que les hommes, confrontés à une dispute permanente à la mesure de leurs passions, arrivent à reconnaître leur intérêt particulier dans une forme de bien commun, la marchandise. le commerce permet de brider les passions. En effet, il établit le lien social entre vendeurs et acheteurs dans un juste équilibre puisque l'un et l'autre mûs par le profit marchand, y entendent raison et y soumettent leur cupidité au lieu de la transformer en agressivité.
- La cité de Dieu ou la cité inspirée : la cité de Saint AUGUSTIN, quant à elle, définit le modèle de cité dans laquelle les relations harmonieuses assurent la concorde entre les êtres. Le fondement de cette cité reposerait sur l'inspiration conçue sous la forme de la grâce. Abstraction de la cité des hommes, ce modèle s'est réalisé dans "les nations", "les républiques", "les peuples".
- Dans la cité de renom (ou de l'opinion), la grandeur d'une personne repose sur l'opinion des autres et est indépendante de l'estime que la personne a d'elle-même. Les litiges surgissent lorsque l'écart se creuses entre cette estime et celle que les autres lui portent et qui est seule, dans la réalité. L'exemple de cette cité est celle de la cour : si le grand est grand par les faveurs qu'il y trouve, il est aussi petit car, serviteur lui-même, il est mis en équivalence avec son propre domestique. La tension de la grandeur du renom et de la grandeur domestique entraine l'ébranlement de l'ordre des personnes, donc de la cour et libère un espace pour d'autres cités (la cité industrielle notamment).
- Dans la cité domestique (qu'aurait décrite BOSSUET), l'individu se soumet au prince car celui-ci "fait , pour le bonheur commun, le sacrifice de ses satisfactions personnelles". "Dans cette conception sacrificielle de la grandeur du Prince, la célébration de ses vertus consiste à faire voir, dans toutes ses dimensions, l'ampleur du sacrifice auquel il consent pour le bonheur commun, auquel il subordonne la totalité de ses satisfactions personnelles" (BOLTANSKI et THÉVENOT, 1991).
- Dans la cité civique, le souverain qui n'est plus roi, est constitué "par la convergence des volontés humaines quand les citoyens renoncent à leur singularité et se détachent de leurs intérêts particuliers pour ne regarder que le bien commun" (Idem).
- Le modèle de cité industrielle prend sa source dans les écrits de SAINT-SIMON. Cette cité est fondée sur l'objectivité des choses. C'est un corps organisé dont toutes les parties contribuent d'une manière différente à la marche de l'ensemble. L'objet de la cité industrielle c'est la "société". Tout doit concourir à sa gestion : calculs des coûts, règles comptables, sciences de la production auxquels s'ajouteront au XXe siècle l'organisation du travail, les instruments de contrôle et de mesure, la standardisation, etc.
Bref, dans chaque type de cité, l'individu trouve la forme universelle de son intérêt particulier. La sociologie et l'économie qui semblent s'opposer par le traitement qu'elles font de l'homme, l'un valorisant le collectif, l'autre l'individuel, ont, en fait, d'après les conventionnalistes, une structure originelle identique, reposant sur une même transformation, celle du supérieur commun en loi positive, (la volonté générale ou le marché). Cette démarche, estiment-ils, est de nature métaphysique, destinée à demeurer abstraite tant qu'on n'aura pas pris en compte la diversité des accords qui font la trame de la réalité sociale? La constitution permanente de ces accords, est, selon eux, au coeur de la confrontation des individus en tant qu'êtres vivant ensemble. En effet, à tout instant, il faut qu'un principe ayant valeur d'équivalence puisse être reconnu comme ayant une valeur universelle et permettent l'établissement d'accords qui réalisent le lieu de fusion des intérêts particuliers en un intérêt collectif. La construction du modèle repose donc sur des transmutations de trois sortes : collectif/individuel, nature humaine plurielle/modalités de l'action, types de cités/types d'accords. (DURAND/WEIL)
La transformation du monde : le passage d'un monde à l'autre
Les individus, toujours selon les conventionnalistes, sont définis par la capacité de posséder au moins deux états, par conséquent de changer leur état existant. L'axiome de commune dignité les dote d'une puissance identique d'accès à tous les états tandis qu'un ordre relatif aux états qualifie les personnes. Ce sont là autant d'attributs qui vont créer des sentiments d'insatisfaction et de contestation sur leur situation, modifier l'équilibre général et en générer d'autres. la dynamique du système est ainsi en germe dans la caractérisation même des individus. De la même façon, la caractérisation d'un monde n'est jamais définitive, car celui-ci contient toujours la trace d'autres natures, même réduites à l'état de contingences. Mais la diversité de ces contingences se tient aux confins des mondes (ou des natures) et bruissent jusqu'à devenir des tohu-bohus remettant alors en cause la distribution harmonieuse des grandeurs et les états des personnes. (DURAND et WEIL).
Parvenus à ce stade de réflexions, les conventionnalistes, dans leur réflexion sur ces mondes et les relations entre eux, sont obligés de tenir compte des conflits et d'une certaine manière de constater, au-delà de statuts des personnes définis de manière plus ou moins stables dans chaque monde, que la dynamique des changements résident en ces conflits. Mais ils refusent précisément d'aller là, malgré l'observation de la survenance du litige et du procès qui conduit à l'épreuve et à la démonstration des preuves... Car admettre que les dynamiques de changements proviennent de ces conflits qui ne sont pas forcément induits intégralement par les personnes, serait admettre deux choses qui n'entrent pas dans leur système : que le conflits sont au coeur de la dynamique des changements et que ces conflits proviennent de l'existence des structures dans lesquelles les individus sont placés, qu'ils le veuillent ou non. Ils constatent que les personnes contestent la distribution des grandeurs qui leur est attribué dans un monde donné. Mais les situations pour eux, ne sont que "troubles" et remplies "d'incertitude" sur les grandeurs qu'il faut épurer. Cette épuration, pour eux, ce n'est que le retour à une cohérence, à un accord. Comme par postulat, les personnes sont des êtres raisonnables, la contestation se fera autour des jugements, autour des principes supérieurs communs, propres à chaque nature, jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé. Il est évident toutefois que pour juger de la qualité des arguments, on ne peut tout de même pas s'en tenir aux propos des contractants éventuels, car il peut s'y loger d'importances subjectivités irréductibles. Ainsi "pour régler la dispute, lever l'incertitude sur les états de grandeur et les rendre prouvables, il est nécessaire que le modèle de la cité puisse s'étendre à des êtres qui ne sont pas des personnes" (Idem). Lors des disputes, pour contrecarrer la subjectivité des personnes, les choses vont servir de preuve à la définition des éléments de contestation dans l'épreuve de réalité. On peut comprendre que ces choses sont économiques - malgré que certaines des cités décrites soient régies par d'autres principes qu'économiques - vu le contexte dans lequel ce développe cette sorte de sociologie morale. Le modèle de cité qui caractérise les conduites humaines contient des êtres que les personnes (ce que permet l'usage de la notion d'équivalence).
La justice des accords entre les personnes est conforté par la justesse des accords entre les choses."Avec le concours des objets que nous définirons par leur appartenance exclusive à une nature, les personnes peuvent établir des états de grandeur. L'épreuve de grandeur ne se réduit pas à un débat d'idées, elle engage des personnes avec leur corporéité, dans un monde de choses qui servent d'appui" (idem). Comment évalue-t-on les grandeurs des choses? Cela dépend. On peut "selon le monde considéré, donner des épreuves en se réclamant du témoignage d'un grand dont le jugement fait foi, en invoquant la volonté générale ; en payant le prix ; ou encore en s'appuyant sur une expertise compétente. Les formes de connaissance sont adaptées à l'évaluation des grandeurs". Cette insistance sur la quantification des grandeurs nous mènent toujours irrésistiblement, que les auteurs le veuillent ou non, vers des réalités économiques.
La sortie de l'épreuve de réalité donnant lieu à un différend se résout dans le compromis. le compromis est fragile s'il ne parvient pas à être rapporté à une forme de bien commun constitutive d'une cité. Il ne permet pas d'ordonner les personnes selon une grandeur propre à cette cité. Il faut par conséquent doter les objets mis au service commun d'une identité propre, reconstruire une cité fonctionnant suivant les modalités exprimées ci-dessus. Sans cela les êtres continuent à maintenir leur appartenance d'origine et la dispute peut être relancée. (DURAND et WEIL).
Et c'est précisément ce qui arrive tout le temps, les accords n'étant toujours que temporaires, constitutifs même des conflits, ces fameuses "disputes" comme les appellent les conventionnalistes comme pour en atténuer la virulence et la permanence. Ils sont convaincus que les personnes raisonnables se réfèrent en fin de compte au bien commun (ce qui reste à démontrer...), mais comment cela s'exprime-t-il? Dans l'élaboration de structures sociales dans lesquelles les individus s'insèrent et pas entièrement consciemment. Mais pour les conventionnalistes, parvenir à cette conclusion serait reconnaître la société comme s'imposant à l'individu. Pour eux, il s'agit d'élaborer une sociologie de l'accord et non une sociologie du conflit.
SOCIUS




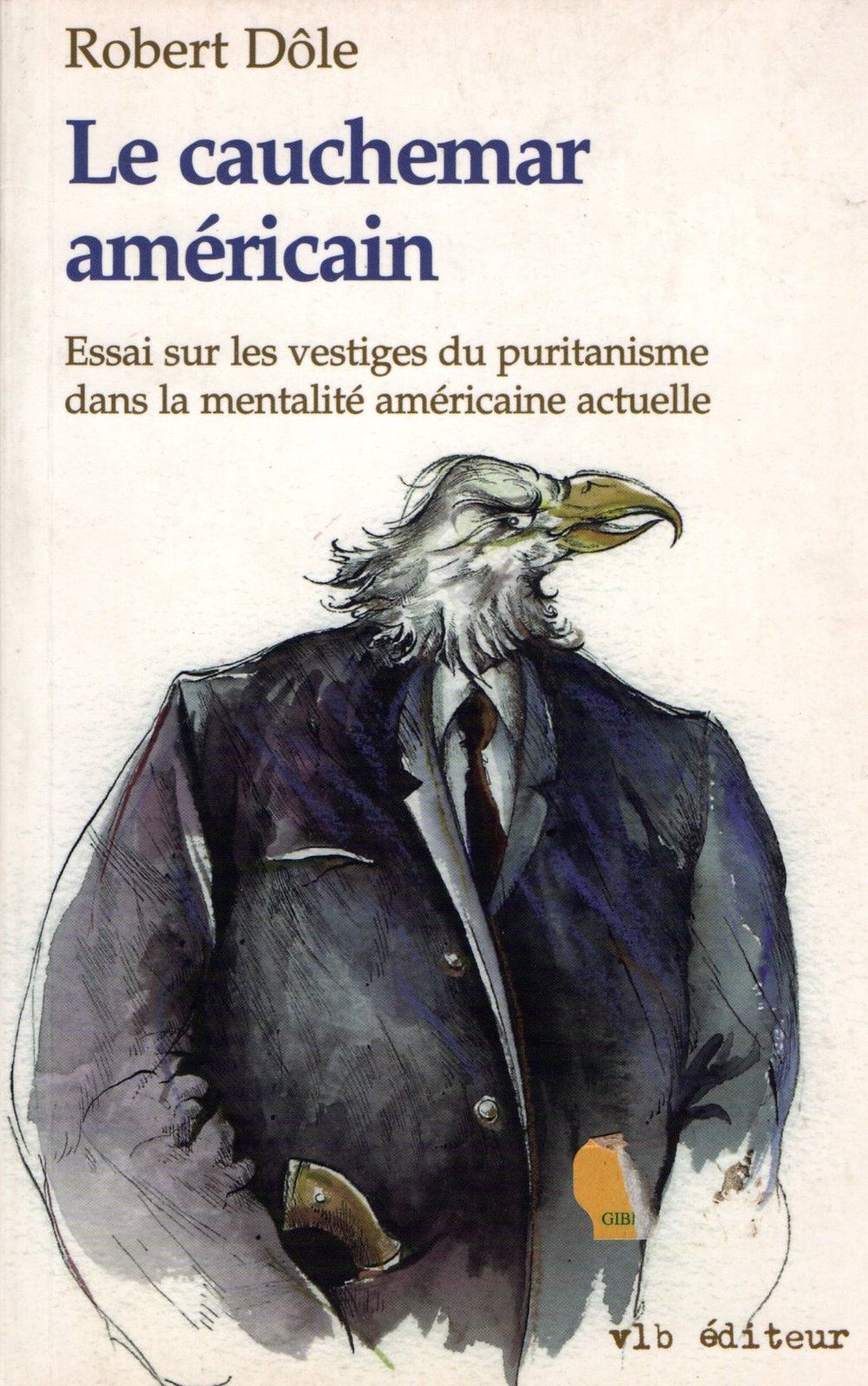
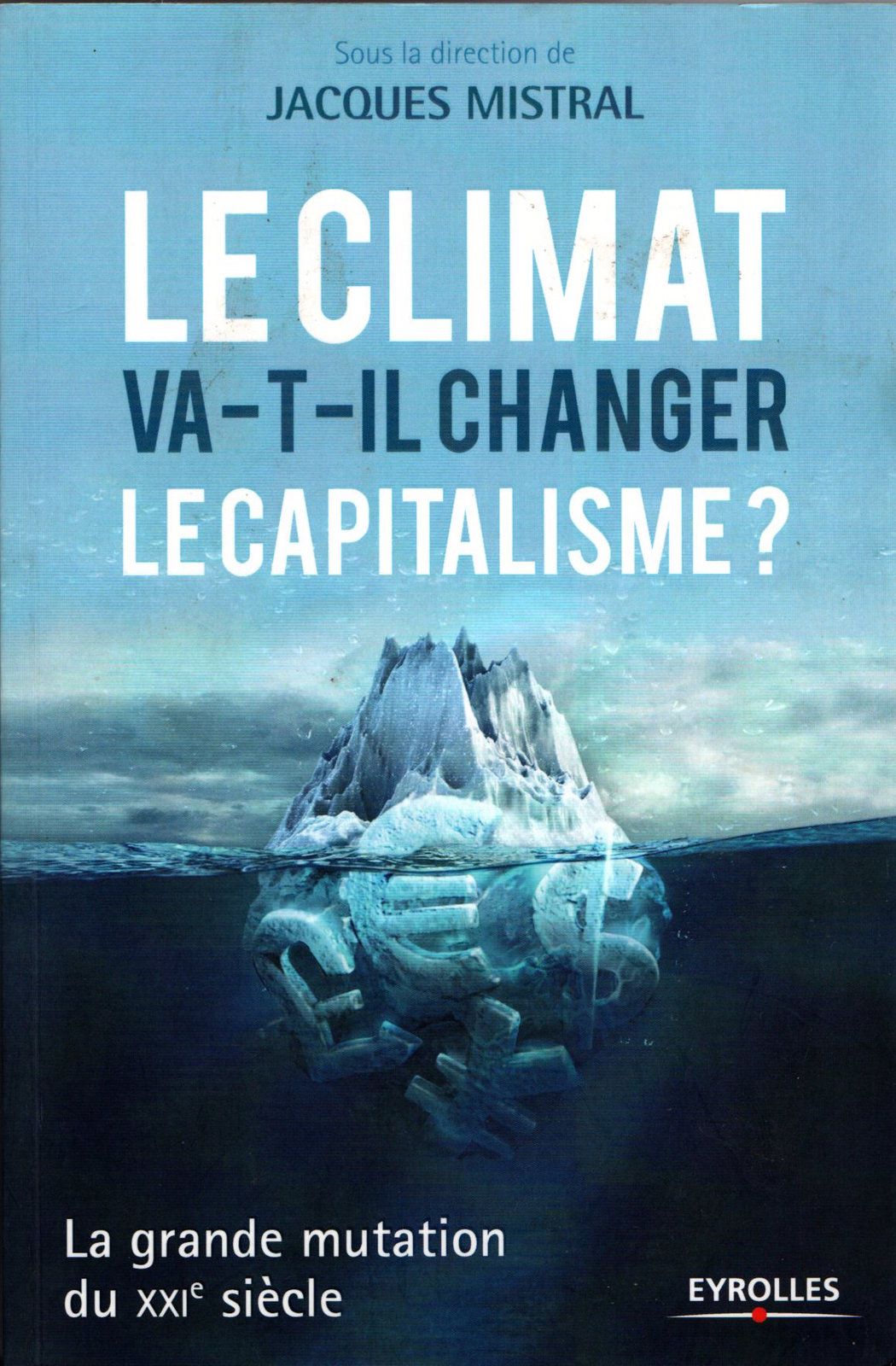
/file%2F1416924%2F20200606%2Fob_63d220_sans-titre.pages)